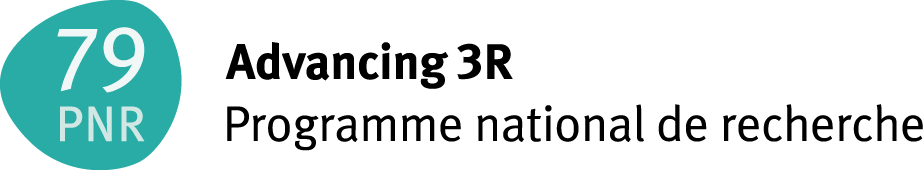Une bonne mort ? Le poids de l’euthanasie pour les soignant·es et les scientifiques

En vue d’acquérir une meilleure compréhension de la charge mentale que représente l’euthanasie des rongeurs, un atelier a été organisé afin de recueillir les points de vue des soignant·es, des scientifiques et des vétérinaires.
En Suisse, plusieurs centaines de milliers de rongeurs sont euthanasiés chaque année au moyen de CO2 parce que les expériences auxquelles ils participaient sont achevées, ou qu’il s’agissait d’animaux excédentaires. Cette méthode suscite des critiques de plus en plus vives, car ce gazage serait susceptible de provoquer des douleurs, de la peur et des difficultés respiratoires avant qu’ils ne perdent connaissance. L’euthanasie constitue également une souffrance morale non négligeable pour les personnes chargées d’effectuer des expériences et de leur administrer des soins comme pour les chercheuses et chercheurs. Le projet de recherche mené par Sonja Hartnack et son équipe a pour but de développer des critères éthiques en vue d’évaluer les méthodes d’euthanasie et d’élaborer des stratégies d’intervention qui permettent d’améliorer le bien-être des animaux de laboratoire et des personnes qui pratiquent l’euthanasie. Il vise également à renforcer la résilience de ces personnes tout en améliorant la qualité et l’éthique des procédures correspondantes.
Vous avez récemment organisé un atelier pour raffiner les procédures d’euthanasie auxquelles sont soumis les rongeurs. Quelles impressions en avez-vous retirées et êtes-vous déjà parvenue à des conclusions importantes ?
Cet atelier fait partie d’une série de quatre que nous avons réalisée en collaboration avec une théologienne protestante et une infirmière expérimentée dans l’accompagnement des personnes en fin de vie. L’objectif était de recueillir les perspectives des soignant·es, des scientifiques et des vétérinaires, notamment en ce qui concerne la gestion de la détresse morale – c’est-à-dire du stress psychologique qui survient lorsque l’euthanasie suscite des conflits éthiques.
Nous avons recouru à différentes méthodes, des jeux de rôle, des dessins et des discussions de groupe, pour recueillir les expériences et les émotions vécues par les participant·es. Pendant l’atelier, nous avons également veillé à leur donner des conseils afin qu’ils puissent développer une résilience, par exemple en les invitant à discuter des cas rencontrés entre collègues ou lors d’échanges structurés.
Il nous importait de mieux comprendre le stress auquel sont exposées les personnes chargées de dispenser des soins aux animaux, car ce sont les plus directement et fortement concernées, et que leur détresse morale pourrait entraver leur capacité à mettre en œuvre les principes 3R dans l’expérimentation animale.
La question de ce qui constituerait une bonne mort faisait notamment partie des principaux sujets abordés durant l’atelier, de même que l’importance du cadre temporel et d’un traitement respectueux lors de l’euthanasie, le sentiment d’un manque de sens lorsque la raison de l’euthanasie n’est pas compréhensible, ou encore la perception qu’ont d’eux-mêmes les soignant·es et les scientifiques qui sont souvent stigmatisés par la société. Certains ont indiqué qu’ils trouvaient particulièrement pesantes les situations dans lesquelles des familles entières d’animaux devaient être éliminées et que l’impossibilité de joindre des supérieur·es hiérarchiques en cas de crises aiguës s’avérait aussi problématique.
Quelles sont les personnes qui ont participé à l’atelier et comment leurs différentes visions ont-elles enrichi le projet ?
Nous avons surtout échangé avec des soignant·es animaliers, des scientifiques et des vétérinaires de laboratoire. Durant l’atelier, il est clairement apparu que beaucoup de chercheuses et de chercheurs avaient jusqu’alors peu prêté attention au point de vue des soignant·es et aux défis auxquels ils sont confrontés. De la même manière, les soignant·es n’avaient souvent qu’une vague idée de la position des scientifiques et des obligations auxquelles ils doivent répondre. Ces échanges ont permis une meilleure compréhension mutuelle.
L’atelier a également mis en évidence que les jeunes chercheuses et chercheurs souffraient de conflits notables quant au rôle qu’ils doivent assumer lorsqu’ils sont contraints par leurs supérieur·es de procéder rapidement à des expériences ou à des euthanasies sans avoir été suffisamment introduits à ces procédures ou accompagnés.
Ce partage a permis d’éclairer ce thème à partir de différents angles et de promouvoir le dialogue entre les parties prenantes. Les participant·es ont ainsi pu mieux appréhender quelles sont les difficultés éthiques et pratiques rencontrées par les autres groupes.
Où en est actuellement votre projet de recherche ?
Parallèlement aux quatre ateliers, nous préparons une étude pilote qui s’appuie sur la technologie du eye-tracking : un procédé qui permet de suivre et d’évaluer les mouvements oculaires d’une personne afin d’en tirer des conclusions sur son attention, ses processus mentaux et ses prises de décision. Notre but est d’analyser comment les professionnel·les réagissent visuellement et émotionnellement à des vidéos d’euthanasie.
Nous prévoyons aussi de procéder à une importante étude internationale en ligne afin d’élaborer un questionnaire validé sur le thème de la détresse psychologique pour recenser systématiquement, et mieux comprendre, les situations qui sont source de stress.
Nous sommes actuellement en train d’analyser des données et de développer des instruments dans l’objectif de mettre en œuvre les prochaines étapes dans le courant de l’année prochaine et de publier ensuite les résultats. Le projet devrait se poursuivre au minimum jusqu’à fin 2026.
Comment avez-vous prévu de transférer les conclusions du projet dans la pratique ?
Nous planifions d’exploiter les résultats de l’étude du eye-tracking et du questionnaire en ligne pour développer des interventions concrètes en vue de prévenir la détresse morale. Il s’agira notamment d’élaborer des outils afin d’introduire les spécialistes au domaine de l’euthanasie et de mieux les accompagner à travers des formations structurées, des supervisions et la conception de formats d’échanges collégiaux.