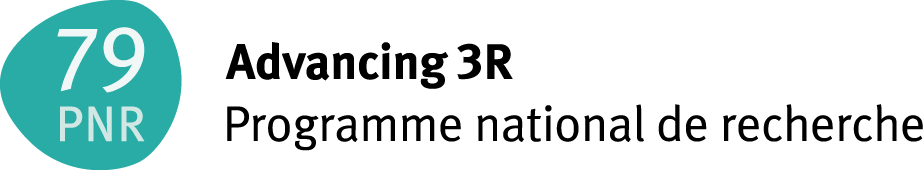Axes de réflexion sur l’avenir de l’expérimentation animale

Le 27 novembre 2025, le PNR 79 organise à Berne un symposium sur l’avenir de l’expérimentation animale et de la recherche 3R en Suisse. Herwig Grimm propose ici quelques réflexions sur l’apport scientifique au dialogue sociétal.
Quel pourrait être l’avenir de l’expérimentation animale en Suisse ? Quelles sont les stratégies actuelles et quels en sont les avantages et inconvénients ? Comment l’Union européenne ou les États-Unis évoluent-ils dans ce domaine et en quoi la Suisse est-elle impactée ? Le 27 novembre 2025, le PNR 79 organise à Berne un symposium scientifique sur l’avenir de l’expérimentation animale et de la recherche 3R en Suisse. Cet événement réunira des expert·es de la recherche, de l’administration, de l’industrie et d’ONG de Suisse et de l’UE.
En amont du symposium, Herwig Grimm, président du comité de direction, revient sur les développements actuels en matière d’expérimentation animale et explique la contribution que peut apporter la recherche à un dialogue circonstancié au sein de la société.
M. Grimm, en quoi le symposium du 27 novembre est-il important, surtout aujourd’hui, pour la Suisse et les autres pays ?
Nous observons actuellement une évolution notable du débat entourant l’expérimentation animale, en Suisse comme ailleurs. Aux États-Unis, l’autorité compétente en matière de produits alimentaires et de médicaments FDA prévoit le renoncement aux expériences obligatoires sur des animaux lors du développement de traitements aux anticorps monoclonaux et d’autres médicaments. L’UE élabore une « feuille de route » visant la suppression progressive de l’expérimentation animale. Les Pays-Bas investissent, par le biais du « Dutch National Growth Fund », un montant de 125 millions d’euros dans le passage à des méthodes innovantes sans animaux. La Suisse n’est pas en reste et prépare la prochaine initiative populaire sur une éventuelle interdiction des expériences avec et sur des animaux.
Comme le montrent ces développements, la question de l’avenir de la recherche biomédicale a donc atteint un nouveau degré d’urgence, y compris en Suisse. Notre symposium du 27 novembre propose un cadre qui permettra d’aborder cette dynamique et de prendre part au dialogue sur la mise en place d’une recherche tournée vers l’avenir.
Quels pourraient être les résultats du symposium du 27 novembre ?
L’expérimentation animale est un thème à la fois complexe et sensible. Le symposium s’appuiera sur les résultats actuels du PNR 79 et l’expertise de spécialistes de renom pour offrir un aperçu des possibilités actuelles, des défis à relever et des scénarios futurs. Nous ciblerons ainsi l’enjeu principal du PNR : réfléchir à des questions de société déterminantes de manière scientifiquement fondée, interdisciplinaire et actuelle et, ce faisant, apporter une contribution active au dialogue.
Dans quelle mesure la preuve scientifique peut-elle influer sur les processus décisionnels du milieu politique ou social – notamment dans un domaine aussi sensible que l’expérimentation animale ?
La réflexion encadrée sur les différentes possibilités de concevoir l’avenir de la recherche est d’autant plus précieuse que la question suscite des débats passionnés et controversés. La science est source de connaissances et la politique décide de la direction à prendre. Pour garantir des décisions politiques fondées, il est essentiel de rapprocher les sphères scientifiques et politiques, de cerner les enjeux et de présenter à la fois les possibilités et les conditions-cadres requises. Au final, ce sont les responsables politiques qui donnent le cap. La science peut mettre en exergue les conséquences souhaitables ou indésirables de ces décisions et clarifier les conditions requises pour aller de l’avant.
Quelle peut être la contribution concrète du PNR 79 à la question de l’avenir des expérimentations animales et de la recherche 3R en Suisse ?
Selon moi, le PNR 79 a déjà montré clairement, après trois années de recherche, que le débat entourant l’utilisation d’animaux à des fins de recherche devait désormais reposer sur une base plus différenciée. Un simple « oui » ou « non » ne mène à rien. Il s’agit plutôt d’identifier des domaines concrets affichant un potentiel en matière de recherche sans animaux et, partant, de développer des stratégies spécifiques et efficaces. Je citerais à titre d’exemple l’interdiction des tests de produits cosmétiques sur des animaux au niveau de l’UE. Globalement, cette mesure est un succès qui repose sur l’interaction réussie entre les aspirations politiques, les alternatives scientifiques et les organisations soutenant cette interdiction.
Quels sont les thèmes largement reconnus au niveau scientifique mais décriés par la société ?
Ici aussi, je pense qu’une réponse simple ne tient pas suffisamment compte de la complexité de la thématique. Aujourd’hui, une grande partie de la population n’accorde plus la même valeur sociale au savoir et à sa production, voire la déprécie toujours davantage. Par ailleurs, la Suisse, à travers l’intégration de la « dignité de l’animal » dans la loi et l’application d’un droit ambitieux en matière de bien-être animal, entend limiter à des cas exceptionnels l’exposition des animaux aux contraintes extérieures ainsi que leur instrumentalisation.
À mon avis, la concomitance de ces deux développements – la perte de confiance dans la science et la prise de conscience accrue de la valeur animale intrinsèque protégée par le droit – explique mieux la dimension fortement émotionnelle qui entoure les expériences animales qu’un argument purement éthique en faveur de la protection des espèces. L’expérimentation animale pose donc, par là même, la question du rôle de la science dans notre société et du rapport existant entre sa valeur et les autres objectifs sociétaux tels que le bien-être animal.
Dans quels domaines discernez-vous le principal besoin d’action pour les années à venir en Suisse ?
L’une des principales mesures auxquelles nous devons nous attacher consiste à proposer des conditions-cadres structurant et soutenant durablement la recherche 3R interdisciplinaire. Cette discipline devrait être intéressante pour les scientifiques et offrir, entre autres, des perspectives de carrière attrayantes. Par ailleurs, le champ de la recherche 3R ne devrait pas être trop restreint : l’innovation scientifique, les stratégies de mise en œuvre et les débats au sein de la société devraient être mis en relation de manière systématique et scientifique. Une telle interaction est un gage de réussite, comme en témoigne le PNR 79.
Un complément d’information et une mise à jour des projets sont proposés sur la page web officielle du PNR 79, dans les newsletters et sur les réseaux sociaux.